 | |  Armes : de gueules, à la fasce d'argent, chargé de trois fleurs de lis d'azur. Armes : de gueules, à la fasce d'argent, chargé de trois fleurs de lis d'azur.
Supports : deux sauvages de carnation, armés de massues.
Cimier : une tête de licorne d'argent.
Couronne de marquis.
Devise : Impavidum Ferient Ruinae (Impassible devant les ruines) et : Amitié de Beaumont
Cri de guerre : BEAUMONT! BEAUMONT
Cette maison, de race chevaleresque, est une des plus illustres de la province du Dauphiné. Son origine remonte à des temps si reculés, que Guy Allard a dit d'elle : « Il n'en est point qui la surpasse en ancienneté; il en est peu qui l'égalent. » |
| |  Christophe de Beaumont du Repaire, Archevêque de Paris |  | Né le 26 juillet 1703 au Château de La Roque à Meyrals (Dordogne), mort le 12 décembre 1781, inhumé à Notre-Dame de Paris
Il fut d'abord chanoine de Lyon et vicaire général de Blois. Prélat pieux et charitable, mais de caractère très ferme, il prit une part importante aux querelles religieuses de son temps. Confronté au parti janséniste, attaqué violemment par le Parlement de Paris à cause de son intransigeance, il fut exilé deux fois de Paris par Louis XV (d'abord à Conflans et Lagny, puis en Dordogne), mais il continua, par la publication de ses mandements et ordonnances, à administrer son diocèse et combattre le jansénisme. Adversaire des philosophes, il condamna l'Émile de Jean-Jacques Rousseau (1762), signalant les erreurs contenues dans l'ouvrage du point de vue de la doctrine catholique. |
| Lettre de J.J. Rousseau à Christophe de Beaumont
Vous trouverez sur le lien suivant l'oeuvre complète qu'écrivit J.J. Rousseau à l'Archevêque de Beaumont. | | 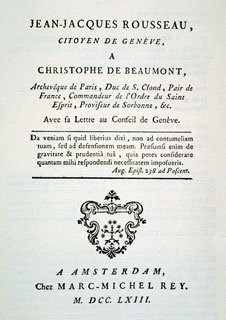 |
|  Ordre du Saint Esprit |  | L'Ordre du Saint-Esprit, était l'ordre français le plus élevé. Fondé par Henri III le jour de la Pentecôte en 1578, en souvenir de sa naissance, de son élection au Trône de Pologne et de son accession au Trône de France, qui tous trois eurent lieu autour de la Pentecôte.
En plus du Souverain Grand Maître, qui était obligatoirement le Roi de France, les membres se répartissaient en 3 catégories :
- 8 Commandeurs choisis parmi les plus vertueux du Clergé (au départ 4 Cardinaux et 4 Archevêques, Évêques ou Prélats, puis indistinctement 8 Cardinaux, Archevêques, Évêques ou Prélâts) et le Grand Aumonier de France qui était Commandeur-né.
- 4 Officiers Commandeurs (Chancelier et Garde des Sceaux, Prévôt et Maître des Cérémonies, Grand Trésorier et Greffier) chargés d'administrer l'ordre, secondés par des Officiers non Commandeurs.
- 100 Chevaliers.
Le Dauphin et les Enfants de France étaient chevaliers à leur naissance, mais ne pouvaient être reçus qu'à partir de 12 ans, les Princes du Sang ne pouvaient l'être qu'à partir de 16 ans, et les Princes étrangers qu'à partir de 25 ans. Pour les autres 35 ans révolus étaient nécessaires. De même, les membres devaient obligatoirement être catholiques et faire preuve d'au moins trois degrés de noblesse paternelle (cette dernière condition n'étant pas applicable pour le Grand Aumonier de France, le Grand Trésorier et le Secrétaire).
Tout Chevalier du Saint-Esprit (à l'exception des ecclésiastiques) devait au préalable être Chevalier de Saint-Michel, si bien que très vite l'habitude fut prise de parler d'un "Chevalier des Ordres du Roi" plutôt que de préciser Chevalier de Saint-Michel et Chevalier du Saint-Esprit. |
|  Baron des Adrets |  | François de Beaumont, baron des Adrets (1513-1587) est né au château de La Frette (Isère).
C'était un capitaine dauphinois et l'un des protagonistes des guerres de religion.
"De 1527 à 1558 François de Beaumont guerroie en Italie, où il se distingue par sa bravoure.
Suite aux massacres de Cahors, Amiens, Sens et Vassy par les Guise en mars 1562, le baron des Adrets prend en avril le commandement des protestants, il pénètre dans Valence avec 8 000 hommes. À partir de cet instant et par des chevauchés fulgurantes, il déroute l'adversaire. Après avoir pris Feurs dans le Forez, le 3 juillet, il marche sur Montbrison à la tête de quatre mille hommes et s'en empare le 14 juillet 1562. C'est là que le baron des Adrets invente les sauteries de la mort. Il se dirigea ensuite directement vers le château de Montrond, où le gouverneur du Forez s'était renfermé. Il y entre le lendemain ; puis, y laissant Quintel, un de ses lieutenants, se retira à Lyon, non sans avoir laissé derrière lui de nombreuses traces de sang. D'une cruauté légendaire, il se fait détester des deux parties et certains épisodes de sa "légende noire" font encore frémir : on raconte en effet qu'il aimait à enterrer ses prisonniers, ne laissant dépasser que la tête, afin que ses soldats puissent jouer aux quilles! Une autre fois, alors qu'il regardait les prisonniers se jeter du haut d'une plate-forme pendant son dîner, l'un d'eux ayant pris deux fois son élan, le baron s'écrie :
c'est trop de deux fois!
A quoi le malheureux répond:
je vous le donne en dix!
Cette répartie lui sauva la vie.
On dit aussi qu'à Montrond, il pilla l'église ; et parce qu'ils étaient trop lents à lui apporter les vases sacrés, il fit, ajoute la chronique, jeter en bas du clocher le curé et le marguillier.
Cette façon de faire la guerre déplaît à Calvin. Le 17 juillet, Il est remplacé à Lyon, par Soubise au poste de lieutenant général. En novembre il rencontre le duc de Nemours, assiégé dans Vienne, qui offre au baron des Adrets le titre de gouverneur du Dauphiné. Mais en décembre Condé le démet de son poste.
Le baron quitte alors la religion protestante et revient au catholicisme.
En 1567, il repart en guerre aux côtés de Gordes sous la bannière des catholiques.
En 1569 il se remet en campagne, mais son infanterie est écrasée à Selongey.
Enfin, dans le Trièves, il gagne sa dernière bataille contre Lesdiguières.
Il meurt dans son lit en 1587". |
| |  Prise de Montbrison |  | Histoire des triomphes de l'Église Lyonnaise, avec la prise de Montbrison par les fidèles au nom du roy.
"Il (le baron des Adrets) braqua donc l'artillerie contre ledict Montbrison le mercredy quinziesme du présent moys de juillet 1562, fist bresche la nuict, fust vaillamment victorieulx, print ladicte ville, occit ou mist en fuiste touts les caffarts et soubztenant de leur querelle. Ceulx de la ville, pour avoir importuné les soudars chrestiens, iecté des pierres des fenestres, et receu chez eux les rebelles à Dieu et au roy, feurent mis à mort avecques leurs complices au nombre de troys ou quatre cens, sauf le plus. Montsala admonesté de son salut par mondict sieur colonel, en cuydant eschapper sa vie avecq onze aultres, saulta d'une tour de troy cens toyses d'haulteur en bas, sur ung rochier, pour rescompense de ses oeuvres..."
Le 7 septembre 1562, les Protestants abandonnèrent la ville de Montbrison.
(Textes extraits de l'ouvrage d'Auguste Bernard,
Histoire du Forez, 1835, tome II) |
|  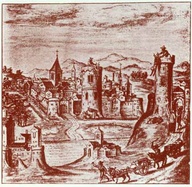 | Les "sauteries" de Montbrison |
|  | je vous le donne en dix... |
|  |   | Maison forte du Baron des Adrets |
|  Ruine du château de Beaumont |  | Les ruines du château de Beaumont sont au sommet d'un rocher (566 m) couronnant un promontoire largement boisé, à un peu plus d'un kilomètre au sud-ouest du Touvet.
le château était constitué essentiellement d'une enceinte rectangulaire s'appuyant au nord-est sur un puissant donjon quadrangulaire. Le sud-est de l'enceinte était occupé par le bâtiment seigneurial et l'entrée (au sud) flanquée de deux tours d'inégale importance. Une seconde enceinte à l'ouest protégeait le château en contrebas, flanquée de deux ou trois tours semi-circulaires (d'après Eric Tasset).
Le château en pierre fut élevé par la famille de Beaumont au début du XIIIe siècle, à la place vraisemblablement d'un premier château en bois sur motte car cette famille est connue dès 1080 en Grésivaudan. En 1304, le château est le principal patrimoine de la famille et est appelé en 1317 "la maison de nos pères". En 1340, Amblard 1er de Beaumont, vassal du dauphin Humbert II, le fait reconstruire car le trouve en piteux état.
Bien que le château fut le siège d'une petite châtellenie indépendante, coincée entre les possessions des Dauphins, c'est dans la maison forte de la Frette que naquit François de Beaumont, Baron des Adrets (1513-1586), chef de guerre successivement protestant puis catholique, dont les exactions sont restées célèbres.
Description de 1339 (extraits) |
|  Maison forte de la Frette | Située sur une roche élevée et dans une position très forte, la maison-forte au molard de la Frette s'établit autour d'une tour carré à trois étages et est entourée de fossés.
Les nobles du mandement : Arthaud de Beaumont, Dragonet d'Entremont, Artaud Louvet, Vivien et Pierre du Touvet, les enfants de feu Raynier du Touvet, Guigonet de St Jean, Pierre et Aymar de St Jean, tous possédant une maison forte ; etc. |
| | |  Cliquez pour obtenir le plan | |
|  |   | Château de Beynac |
| |   | Château de Merville |
|   | Château de Saint Cyrien |
|  Société de Cincinnati | Ordre de Cincinnatus.
Ordre héréditaire, institué le 10-5-1783, reconnu par la monarchie française. Juridiquement, il ne pouvait pas être considéré comme un ordre national (Washington n'étant pas chef d'État lorsqu'il le fonda) mais comme une association héréditaire se prévalant d'un insigne distinctif qui ne peut être considéré comme une décoration. Les statuts ont été rédigés par le Gal Henry Knox (1750-1806), chef de l'école militaire de West Point, qui en devint le secrétaire général (1785-90), puis le vice-Président général (1805). Premier Président général (1783-99) : George Washington (1732-99). Attribué à des officiers supérieurs et généraux de l'armée ou de la marine et à des officiers subalternes blessés ou récompensés. Nombre des 1ers titulaires français : 370 selon le Bon de Contenson, 362 selon l'Américain Asa Bird-Gardiner. Certains officiers français ayant servi dans l'armée américaine ont été admis dans la branche française. Textes officiels de la monarchie reconnaissant l'ordre américain comme « 1er ordre étranger » (l'insigne se portant après la croix de St-Louis) : lettres de Louis XVI du 8-8-1784, confirmées par une lettre du 12-12-1789, au vice-amiral Cte Jean-Baptiste d'Estaing (1729-94, guillotiné ; 1er Président de la branche française), du Cte César-Henri de La Luzerne (1737-89, ministre de la Marine, frère d'Anne-César), Mis de La Luzerne (1741-91, membre fondateur de l'Ordre).
Société des Cincinnati.
Société d'amis groupant les officiers anciens combattants de la guerre d'Indépendance américaine, leurs descendants (culte du souvenir, aide sociale), et, spécialement, les officiers français pour maintenir à jamais des liens étroits avec la France sans laquelle la victoire contre la G.-B. eût été impossible.
But : conserver intacts les droits et libertés de l'individu, maintenir entre les États l'union et l'honneur national à l'exemple de Lucius Quintus Cincinnatus, qui, ayant commandé 2 fois en chef l'infanterie romaine (en 459 et 437 av. J.-C.) avec le titre de dictator, reprit après la victoire son métier de laboureur. Il était prévu au début que la qualité de membre se transmettrait de mâle en mâle par primogéniture, mais, dès 1784, la transmission par les femmes héritières fut admise en cas d'extinction de la lignée masculine. Organisation : dans chacun des 13 premiers États de l'Union et en France (depuis le 18-12-1783), existe une « branche » dirigée par un Président, un vice-Président et un comité, chargés de reconnaître les titres d'un candidat à la succession d'un membre héréditaire, qui est ensuite élu par les membres de l'Ordre.
Insigne : dessiné par le major Pierre L'Enfant (1754-1825 ; 1er secrétaire français) ; aigle d'or américaine avec ruban bleu clair bordé de blanc : l'aigle à tête blanche (bald eagle) a servi de modèle à celle de l'écusson des USA ; il porte un médaillon à fond bleu avec Cincinnatus à sa charrue. Port autorisé en France, épinglé sur le revers droit, le ruban étant remplacé par une rosette. Le Président général reçoit l'aigle ornée de diamants qui avait été offerte le 27-2-1784 à Washington par la marine française. De 1978 à 1980, il y a eu à Washington un vice-Président général français. En 2001, un Français a été élu pour 3 ans secrétaire général et réélu en 2004. Siège social : Société générale représentant les 14 sociétés d'État : Anderson House (Washington DC), qui abrite également le musée de la Société.
Branche française de la « Société des Cincinnati » : à l'aîné des descendants (représentants, par primogéniture, de chaque famille) des généraux, des colonels ou capitaines de vaisseaux et des officiers morts ou blessés au combat pendant la guerre d'Indépendance. A la chute de la monarchie, elle a été « mise en sommeil » (rendered dormant). Le dernier Français d'origine mourut en 1854. Après la guerre de 1914-18 et avec l'accord de la Société générale américaine, la branche française fut reconstituée (4-7-1925) sous le nom de « Société des Cincinnati de France » et sous forme d'une association suivant la loi de 1901. Déclarée le 1-7-1930, reconnue d'utilité publique par décret le 20-7-1976. Siège : 2 bis, rue Rabelais, 75008 Paris. Présidents (depuis 1930) : duc de Broglie (Maurice), duc de Lévis-Mirepoix, duc de Castries († 1986), Cte François de Castries, Gal Jean Melchior Mis de Roquefeuil et du Bousquet, Mis de Beaumont de Verneuil (depuis 2004). Secrétaire général : Cte de Colbert Cannet. Membres (au 1-1-2006) : 321 titulaires et 32 honoraires choisis intuitu personae (à titre personnel et sans hérédité). Louis-Alphonse de Bourbon, duc d'Anjou, membre titulaire depuis 1994, représente le roi Louis XVI. Le Cte de Paris († 1999), membre titulaire (représentant son aïeul le duc de Chartres présent à la bataille d'Ouessant), avait choisi de ne plus l'être.
histoire : http://societpg.alias.domicile.fr/presentation/histoire2.html |
| | |
|

